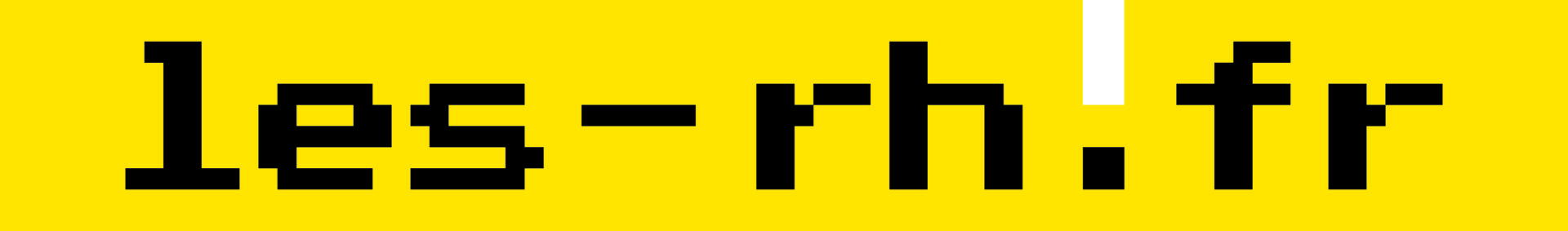En l’espace de quelques décennies, la poursuite d’études s’est généralisée en France, conduisant près de la moitié des femmes et un peu plus d’un tiers des hommes de 25 à 29 ans à être diplômés de l’enseignement supérieur. Une partie importante des jeunes originaires des espaces ruraux et des villes petites et moyennes s’engage dans une « émigration étudiante » à destination d’une grande ville universitaire. Les sociologues Élie Guéraut et Fanny Jedlicki ont mis en évidence que les jeunes femmes tendent plus que les jeunes hommes à quitter leur lieu de résidence à l’issue du baccalauréat, mais également à y retourner une fois leurs études achevées. Ce phénomène apparaît d’autant plus marqué lorsqu’elles sont issues des classes populaires, et concerne en particulier les jeunes femmes originaires des espaces ruraux et des villes petites et moyennes.
Une féminisation de l’émigration étudiante
C’est entre 15 et 19 que les mobilités étudiantes sont les plus nombreuses, avec un afflux de jeunes des espaces ruraux et des villes petites et moyennes vers de grandes agglomérations. Ce pic de départs s’explique par la poursuite d’études et l’inégale implantation territoriale des établissements d’enseignement supérieur, particulièrement déficitaire dans les communes rurales, et les villes petites et moyennes. Lors du recensement de la population de 2013, 26 % des femmes et 22 % des hommes bacheliers de 15 à 19 ans ont changé de lieu de résidence. Dans 52 % des cas, ces jeunes étudiants se sont installés dans une grande agglomération.
Et des retours qui concernent davantage les femmes
Étant plus nombreuses à obtenir leur bac, les femmes ont plus tendance à s’engager dans une mobilité étudiante vers une grande agglomération. Mais elles en repartent aussi un peu plus souvent que les hommes à l’issue de leurs études : 16 % des femmes de 20 à 24 ans diplômées du supérieur quittent des unités urbaines de plus de 200 000 habitants contre 11 % de leurs homologues masculins. À Paris, elles sont 6 % contre 3 % des hommes diplômés de cette classe d’âge à quitter la capitale. Dans un même temps, ces jeunes diplômées du supérieur regagnent, dans près de 40 % des cas, leur département de naissance.
Des choix d’orientation peu rentables sur le marché de l’emploi
Qu’il intervienne avant ou après l’obtention du diplôme, le retour procède d’abord des difficultés subies et/ou anticipées à intégrer le marché du travail qualifié des métropoles (absence de réseaux pour chercher un emploi, crainte de ne pas « y arriver » …), où les jeunes diplômées résidaient jusque‑là en tant qu’étudiantes. L’analyse des données de la plateforme APB (remplacée par Parcoursup depuis 2020) montre que les filles d’employés et d’ouvriers tendent plus que les autres à se diriger vers des filières peu distinctives et/ou non sélectives. Les filles d’ouvriers expriment par exemple plus souvent le souhait d’intégrer une section de technicien supérieur. Les filles d’employés se caractérisent par une tendance à se diriger vers des licences non sélectives de l’université publique, où elles sont surreprésentées dans les départements de langues, de lettres et de sciences humaines et sociales.
Les étudiantes issues des classes populaires ont plus de difficultés à se stabiliser dans les grandes villes
L’émigration étudiante est en effet perçue comme un vecteur d’émancipation sociale chez un grand nombre de jeunes femmes issues des classes populaires. Les grandes villes apparaissent comme un espace de liberté, une ouverture de leur champ des possibles. Cependant, ces aspirations peuvent être rapidement contrariées par l’expérience de difficultés économiques et/ou relationnelles. Les familles les plus modestes sont notamment confrontées à des contraintes économiques, qui peuvent se traduire par l’incompréhension des parents qui refusent de continuer à les soutenir économiquement à la fin des études. Par ailleurs, des ressources culturelles et relationnelles peuvent également faire défaut à l’intégration des jeunes diplômées issues de milieux modestes. De la sorte, certaines jeunes diplômées se retrouvent « éliminées » des grandes villes car elles n’ont pas la capacité financière de s’y maintenir. Les parents mieux dotés aident davantage leurs enfants. Enfin, ces jeunes femmes font parfois face à des injonctions contradictoires de la part de leur famille qui, si elles éprouvent une grande fierté à les voir partir « en études », attendent d’elles dans le même temps qu’elles s’investissent dans des relations de proximité, essentiellement conjugales et familiales.
Étudier ce phénomène dans toutes ces spécificités, notamment du point de vue du genre et des spécificités liées aux espaces d’origine, peut contribuer à mettre en place des politiques publiques plus efficaces, en mobilisant plusieurs leviers : accompagnements étudiants, aides financières aux jeunes mobiles pour leurs études (directes ou indirectes : logements, transports…), aides à l’embauche, etc. afin de répondre à toutes les situations.
| DONNÉES Cette étude utilise les données du recensement de la population 2013 de l’Insee, d’APB (Admission Post-Bac) 2015, ainsi que celles des rectorats académiques de Dijon et de Normandie (2014-2015) plusieurs rectorats académiques (Bourgogne, Haute-Normandie, …). Elle s’appuie également sur deux études sociologique et ethnographique menées notamment au travers d’une série d’entretiens réalisées auprès d’étudiantes issues des fractions stables des classes populaires, résidant originellement dans des espaces ruraux et des villes petites et moyennes de Haute-Normandie et de Bourgogne. |
Pour en savoir plus :
Élie Guéraut, Fanny Jedlicki et Camille Noûs, 2021, L’émigration étudiante des « filles du coin » : Entre émancipation sociale et réassignation spatiale, Travail, genre et sociétés vol. 46, n°2, 2021, p. 135-155.